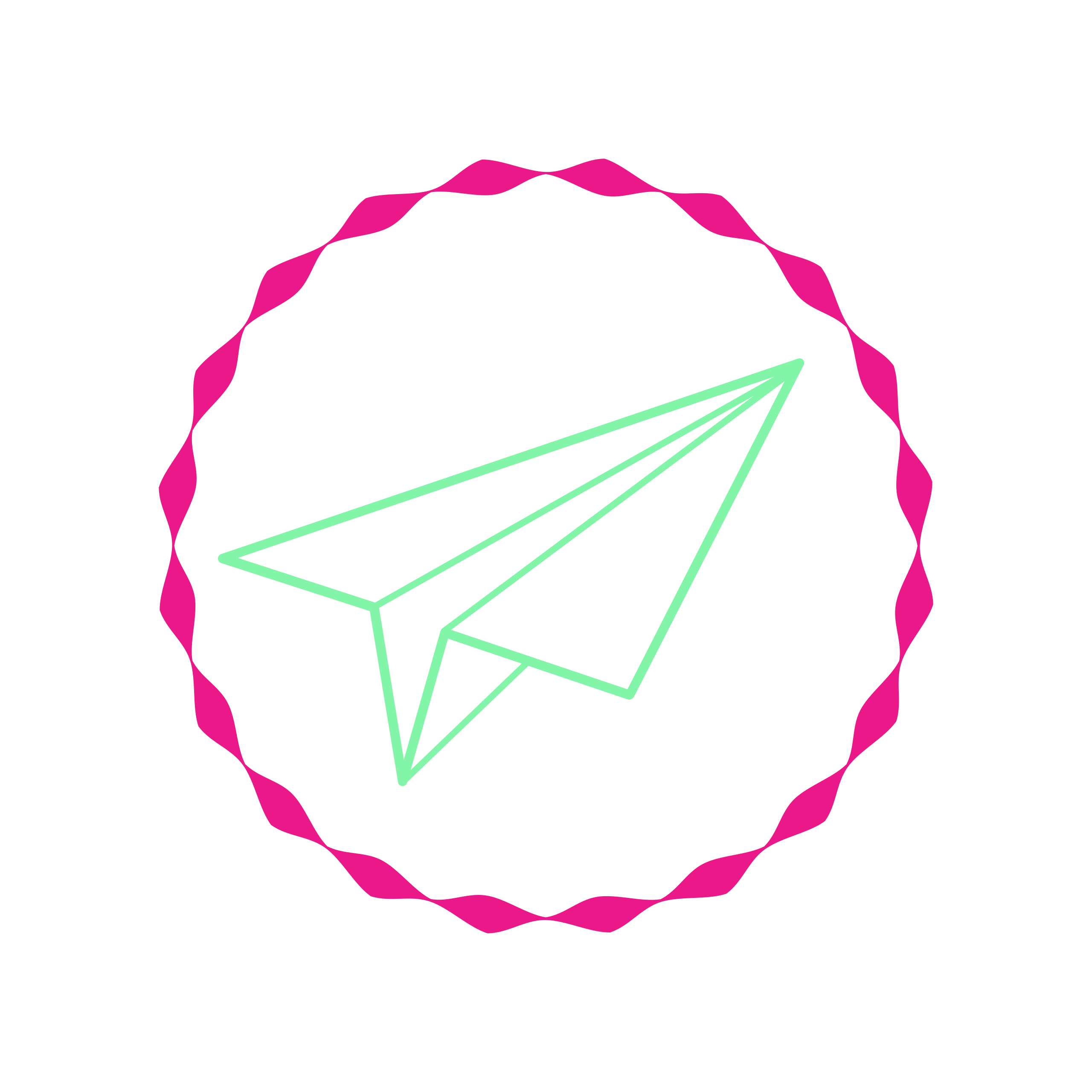Le seigneur des Porcheries
Paul Balagué
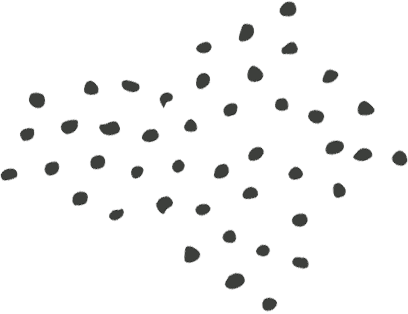
théâtre pour binge-watchers
Il faut un certain culot, ou une certaine inconscience, pour s’attaquer au roman américain. Non pas tant en raison de sa difficulté littéraire, mais parce que ce genre travaille moins le style que la profusion, à coups d’épisodes, de rebondissements, d’accumulations. On pense à cette phrase de Godard : « Les Européens ont une histoire, les Américains des T-shirts ». Et pourtant, il faut bien admettre que la culture américaine est aujourd’hui si hégémonique que la convoquer sur une scène de théâtre n’a plus rien d’absurde. Peut-être est-ce même nécessaire. Car face à la paupérisation des moyens, à la fragilité croissante des institutions culturelles françaises, il faut attirer d’autres financements, toucher d’autres publics. Hortense Archambault à la MC93 l’a bien compris : sa programmation éclectique ouvre le théâtre à ceux qui ne s’y sentent pas spontanément invités et permet à ceux qui en sont familiers de voyager entre les formes.
Pour accroître une audience, une méthode a fait ses preuves : celle du rap. D’abord cantonné à un public restreint, souvent communautaire, il a franchi ses frontières grâce à des figures de connivence : Vanilla Ice, rappeur blanc au tube connu de tous, samplant le très mainstream Under Pressure allant à l’encontre d’un DJ Premier qui samplait pour NAS les disques de jazz de la collection pointue de son père. Le résultat ? Une musique jusqu’alors marginale devient consommable par le plus grand nombre. Paul Balagué, en adaptant Le Seigneur des porcheries, agit de même. Il pioche à pleines mains dans la culture populaire : la pose à la proue du Titanic, lecostume iconique d’Assassin’s Creed, les viols et combats sanglants de Game of Thrones, les hordes de morts-vivants se jetant d’une falaise dans Walking Dead, le royaume pourri du Danemark… Ici, loin de l’élitisme, on cherche la reconnaissance complice du spectateur.
Et cela fonctionne. Le spectateur se reconnaît, il rit, il suit, il reste. Le spectacle dure cinq heures, mais les adeptes de Netflix, eux, savent binger au risque de l’amnésie. L’esthétique de la série se glisse entre les mailles de cette épopée ouvrière, où l’on ressuscite John Kaltenbrunner, leader assassiné d’une grève d’éboueurs, devenu martyre, mythe, messie. On est plus proche des Evangiles opium du peuple que du Manifeste du Parti communiste : le héros prend ici la figure d’un Christ sacrifié et absent, incarné à tour de rôle par ses apôtres qui viennent nous raconter ses miracles, sans jamais vraiment nous dire ce pourquoi ils se battent.
La mise en scène opère à la truelle. Elle accumule, superpose, enfile les références comme d’autres enfilent des couches de vêtements dans une salle mal chauffée. C’est parfois lourd, souvent drôle, toujours excessif. Mais peut-être fallait-il cette surcharge pour rendre hommage à un roman fleuve. Paul Balagué veut tout dire, tout montrer, tout jouer. Et il y parvient – presque. Parfois, le verbe enfle jusqu’à l’excès. Ces tirades s’allongent à force de synonymes alignés quand un seul mot aurait suffi. Le texte peut être beau, mais il apparaît vite comme un système poétique d’inflation verbale, magnifiquement porté par des comédiens qui débitent le texte à toute vitesse — prouesse qui flirte parfois avec le cabotinage. Mais pourquoi ne pas bouder ce plaisir ? Alors on se demande si tout cela va quelque part, si ce n’est pas de l’art pour l’art. Quelle est donc le sens de tout cela ? Simple divertissement ? Geste politique ?
On oscille sans cesse entre plaisir et conscience, sans jamais trancher. On nous parle de grève, de lutte, et pourtant, aucune thèse ne se dégage vraiment. Est-ce le choix de l’ambiguïté ou l’effet d’une saturation narrative ? Kaltenbrunner est tour à tour martyr, ingrat, prophète, fils indigne, ouvrier radical : difficile d’en tirer une morale claire. Le monde qu’on nous donne à voir est fluctuant, sans boussole, comme le nôtre. On pense à cette loi implicite des fictions dystopiques : nous empêcher de rêver l’utopie, nous familiariser avec l’imperfection jusqu’à la résignation. Comme dans les jeux vidéo, où la mort n’a pas de conséquence, où chaque échec peut se réinitialiser. Un théâtre pour adulescents ? Ce serait trop simple. Car la question reste en suspens : qui est encore véritablement responsable ?
Comment ne pas se laisser embarquer ? Le plateau est une cour de récréation sale et grandiose, investie par les comédiens avec une fougue rare. En ce sens, l’influence de Vincent Macaigne affleure : le quatrième mur se disloque, la salle est happée dans le tumulte, les corps vocifèrent, s’épuisent, s’exposent. Mais ici, le tumulte est dirigé, canalisé, structuré — une fureur tenue. On pense aussi à Sylvain Creuzevault, bien que la dimension spéculative, philosophique ou dialectique y soit moins présente. L’avalanche de jurons — “merde”, “putain”, “pisse” — convoque les Chiens de Navarre et leur nihilisme goguenard. Les costumes frôlent le grotesque à la Deschiens. Les figures sont celles de la déchéance flamboyante, comme surgies d’un univers à la Breaking Bad, tragiques par excès de médiocrité. La scénographie, saturée de fumée, évoque un show gothique de Mylène Farmer sous acide, où le mauvais goût est peut-être un refuge, ou une provocation. On pourrait croire à un inachèvement, une désœuvre, un chaos sans cap. Que voulez-vous quand on manque de moyens ? Mais quelques détails démentent cette impression : l’évocation de l’interprétation aussi magnifique que confidentielle de Wicked Game de Chris Isaac par Pipilotti Rist, clin d’œil discret à David Lynch, vient signaler une strate plus souterraine, plus raffinée. Ce théâtre, assurément, ne relève ni de la métaphysique flamboyante d’un Castellucci, ni de l’ascèse silencieuse d’un Régy. Paul Balagué, passé par Mnouchkine, a retenu l’essentiel : la générosité. Celle du conteur, de l’artisan d’une œuvre-monstre, d’un récit total qui emporte tout sur son passage. Il ne faut pas s’attendre à une épure mystique ou à une métaphysique de plateau. C’est un chaos organisé, une apocalypse joyeuse, une catharsis bruitée. Ce n’est pas sobre, ni calme. C’est trop. Mais ce trop touche. Parce qu’il se donne tout entier.
Et c’est cela, peut-être, le plus bouleversant. Là où l’on attendait un manifeste politique, on trouve un malaise plus précieux encore : celui d’un monde qui se cherche, d’un collectif qui s’accroche à la narration pour survivre à la violence systémique. Les comédiens tiennent bon, jusqu’au bout, et le public aussi. Ovation. Cinq heures plus tard, le plateau est un champ de ruines, mais le lien est là. Viscéral, fragile, magnifique. Le théâtre, au fond, n’a pas besoin d’autre justification que celle-là : tenir ensemble.
Thomas Adam-Garnung