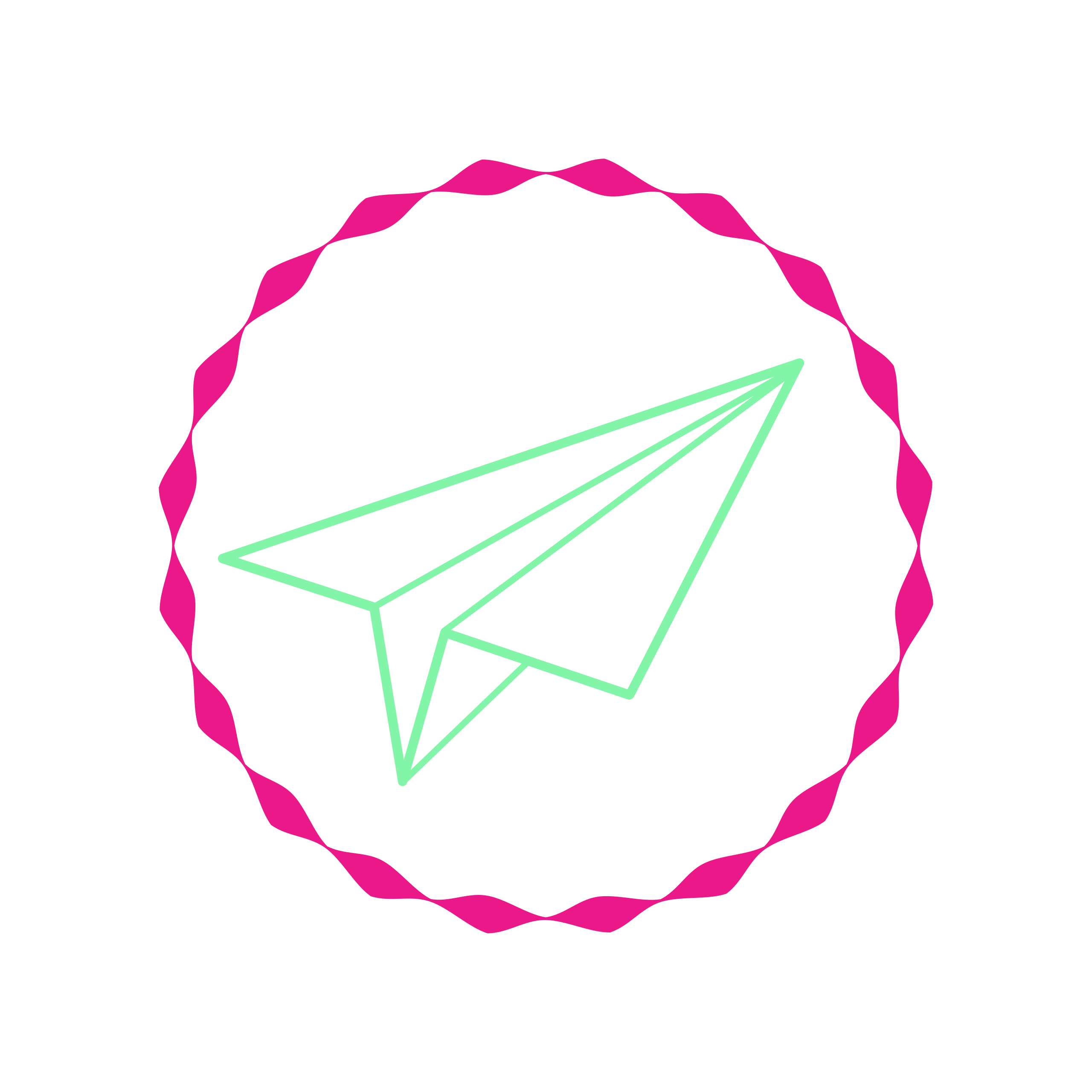Inaugural
La Tierce
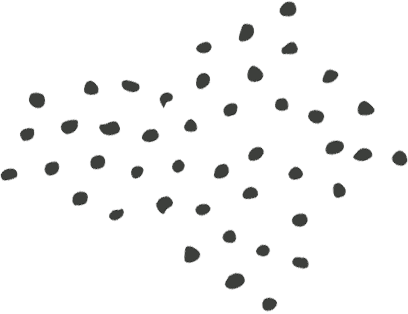
La valeur n'attend pas le nombre des années.
Aux chorégraphes patentés, ceux qui dirigent des institutions ou s’y endorment, ceux qui bien installés ressassent inlassablement les mêmes motifs, ceux qui ne font plus que suivre les modes appliquant des recettes marketing distillées par des agences de com’, on ne demande rien ou presque, juste peut-être qu’ils fassent du bruit de façon dispendieuse. Ils sont comme les vieux comtes de la pièce de Corneille : parés de rubans, le verbe haut, l’épée émoussée, ils se pavanent sur toutes les scènes. La Tierce, association d’artistes chorégraphiques portée par Sonia Garcia, Séverine Lefèvre et Charles Pietri, a tout du Cid : la passion, la fougue, la générosité. Gageons qu’ils sauront réveiller la danse de sa torpeur.
Car Inaugural, leur nouvelle création, est un coup de maître. Rien n’y est laissé au hasard. Tout est calculé au cordeau. Ils y sont tenus. C’est une architecture.
Sur le plateau, des pierres, des tasseaux dessinent dans un équilibre apparemment précaire des formes dont il est bien difficile de dire ce qu’elles représentent : la structure à terre d’une maison détruite par une catastrophe, le geste un peu vain de quelqu’un qui veut signifier sa présence en ayant ordonné le chaos ? Certaines parties sont peintes en bleu Klein, d’autres ont été laissées brut. Et le sol est d’un turquoise digne d’un lagon. C’est très plastique. On peut penser à certaines pièces de Keersmaeker qui commençaient en montrant que la danse, c’est déjà un corps qui souffle dans une flute, ou une centaine de métronomes déclenchés en même temps. Ce qui est sûr c’est que chez La Tierce, le plateau n’est pas un lieu neutre, c’est toujours un lieu instable, où peuvent advenir des accidents, où règne une certaine tension et qui pousse le spectateur à imaginer, inventer, ressentir.
Alors qu’au moindre faux-pas, à la moindre erreur tout s’effondrerait, sans aucune fébrilité, bien au contraire sereins et assurés dans leurs gestes, les danseurs commencent à vider le plateau. Et c’est un véritable ballet, millimétré, accompagné par un texte de Duras dit à deux voix qui se courent après, se rattrapent et se croisent. Ça parle de mains peintes sur des parois, de falaise et de cris d’amour. On ne saisit pas tout. Ce n’est pas le propos. Plongés par le calme presque méditatif et la concentration extrême des interprètes dans une transe, nous voilà amenés à tisser des liens : le turquoise pour la mer, le bleu Klein pour les éponges marines mais aussi pour ses anthropométries, empreintes de corps de femme sur la toile, écho aux empreintes de mains des hommes préhistoriques dont parle Duras. On voyage. On se prend à visualiser les falaises. Et on se dit que tout ça parle d’absence, d’une absence qui appelle une présence. Que ce sont deux versants d’une même réalité. Que si l’absence est une présence en creux, alors la présence est peut-être une absence en relief. Et la danse dans tout ça ? La danse, c’est le geste qui dit l’amour. Un amour qui se donne, se crie. La danse ramenée non pas à une virtuosité arbitraire et maniérée, mais bien plutôt à une prise de position dans l’espace, dessinant des paysages, reliant différents objets entre eux.
Voilà une œuvre d’une grande maturité et d’une infinie finesse.
Thomas Adam-Garnung
La Tierce :