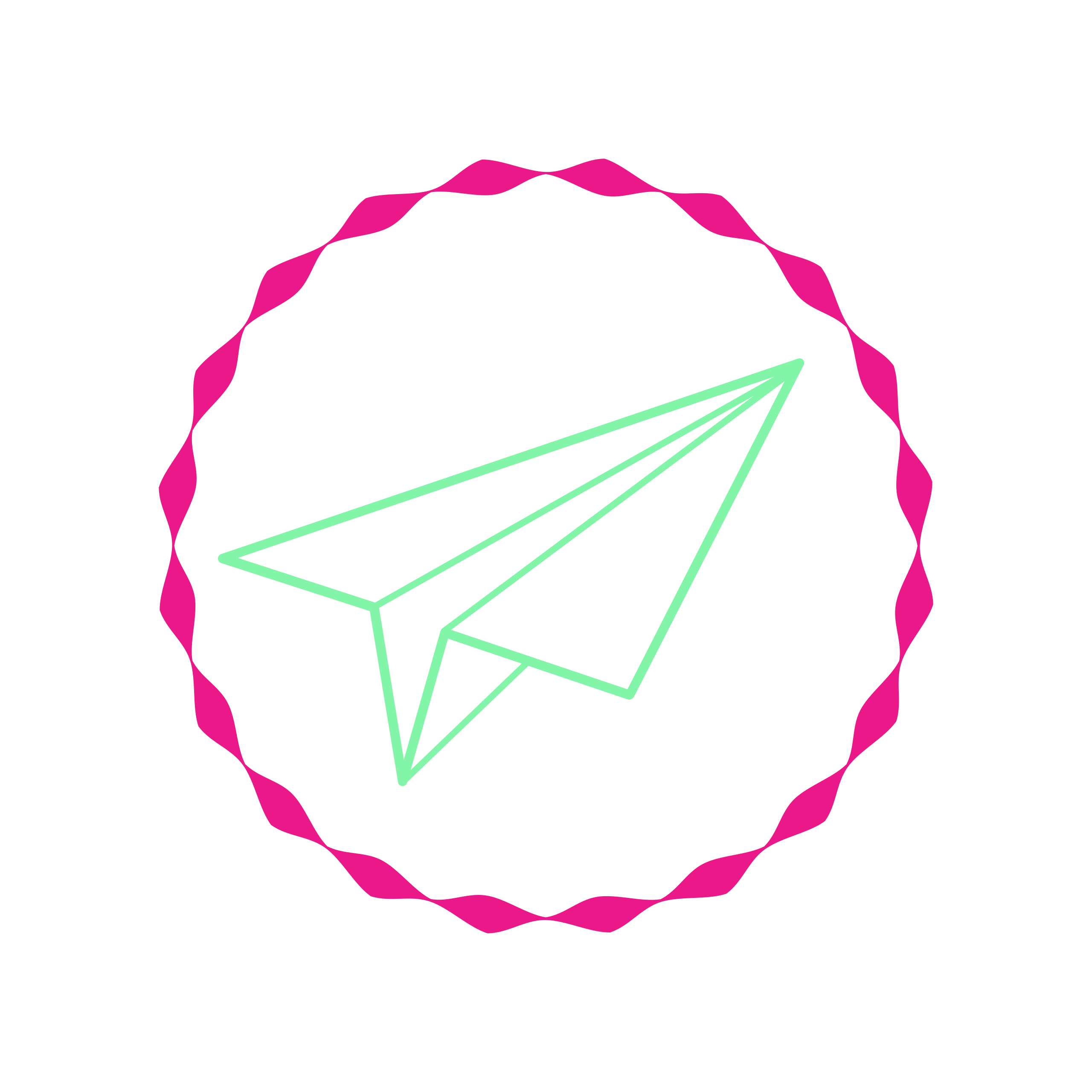Avant la terreur
Vincent Macaigne
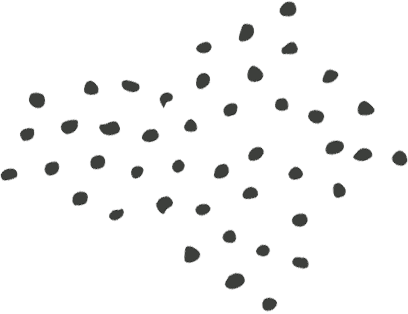
gimmicks à gogo
Cela faisait quelques années que Vincent Macaigne avait délaissé le théâtre pour le cinéma où on le découvrait étonnamment assagi, calme et posé, parfois romantique, doux, presque en finesse, timide, en un mot : policé. Et donc bankable. Et c’est avec impatience qu’on attendait de lui qu’il retrouve ses excès, ses fulgurances, ses outrances. Celles qu’on lui avait connues à Avignon notamment où il avait déjà dynamité Shakespeare de l’intérieur, éclaboussant au passage le public de divers fluides plus ou moins douteux pour le plus souvent déclarer sa flamme, démontrer qu’il était un amoureux éperdu si ce n’est de l’autre, de l’humanité au moins. Le public aujourd’hui entre dans la salle et on sent bien que c’est ce qu’il réclame, des cris, des éructations, des éclaboussures, une certaine audace, de l’irrévérence, un bordel foutraque et humaniste en somme qui ferait quelque peu pétiller notre morne journée. Il trépigne le public, il ricane, de cette connivence de ceux qui savent qu’ils vont assister à quelques scandales scéniques qui font dates, du croustillant salace dont on pourra se délecter entre soi pour dire j’y étais. Pourtant il y a là Nicolas Maury, Olivier Py, Claire Chazal, les happy few du théâtre contemporain français en nombre qui on le sait ne se laisseront pas éclabousser eux, on leur doit les égards les plus élémentaires, la bienséance des puissants. Leur présence semble plutôt signifier que l’audace attendue est rentrée dans le rang, comme une posture plutôt que comme une éthique. Incapable de déranger, vidée de sa substance donc. Mauvais augure.
Pour son grand retour Macaigne décide de s’en prendre à Richard III, c’est ce qu’annonce la feuille de salle, le dossier de presse. Mais de Richard III, il ne reste plus grand chose au final. Comme si le chef d’oeuvre était devenu cette fois trop grand face à la démesure de celui qui n’avait pas flanché face à Hamlet. Macaigne va plutôt convoquer les réseaux sociaux, la crise climatique, une démocratie malade, les horreurs du monde, on se croirait chez nous, pas le moindre dépaysement, plutôt le contraire même. Ce sentiment étrange d’être assis là, dans un théâtre, assistant à ce qui fait notre quotidien plutôt qu’à une représentation. Et comme de bien attendu, c’est sale, mais personne n’en sortira sali, personne dans le public ne sera éclaboussé. Comme de bien attendu, ça crie, on se fait littéralement engueuler. Et cette engueulade finit d’achever l’impatience heureuse des spectateurs, le silence a remplacé les ricanements, l’apathie s’est emparé de la plupart. Et c’est ce dont les autres critiques font état, plus mauvaises les unes que les autres. Car malgré ce que semble dire Macaigne, son propos ne s’adresse pas à nous. Celui qui use de la violence c’est lui, celui qui pollue dans une débauche de moyens c’est lui. Celui qui se sert de ses privilèges, de ses passe-droits, c’est encore lui. Et celui qui revendique sa bêtise, son ignorance, c’est toujours lui. Richard III ce n’est pas nous. C’est Vincent Macaigne. Et le spectacle tout entier semble là pour nous le faire détester ce trublion qui avait enchanté autrefois la critique. Les gimmicks sont là. Les acteurs vocifèrent et c’est ce qui semble permettre l’absence même de mise en scène. Lorsque l’un deux se met à débiter une tirade les autres se figent comme n’importe qui se figerait, sidéré par l’hystérie de celui qui parle. C’est une succession de monologues dont certains sont parfois poétiques et bien trouvés mais la plupart sont comme des brèves de comptoirs, des considérations sans conséquence que l’on se fait au détour d’un voyage en train, petites notes sans lien consignées dans un petit carnet. Ça ne vole pas très haut. Et les acteurs en roue libre se mettent à pasticher Audrey Bonnet, Jacqueline Maillan ou Fabrice Lucchini. 7 ans plus tard, il n’y a plus rien de subversif chez Vincent Macaigne. Et lorsque Richard III meurt enfin c’est comme un soulagement.
Thomas Adam-Garnung