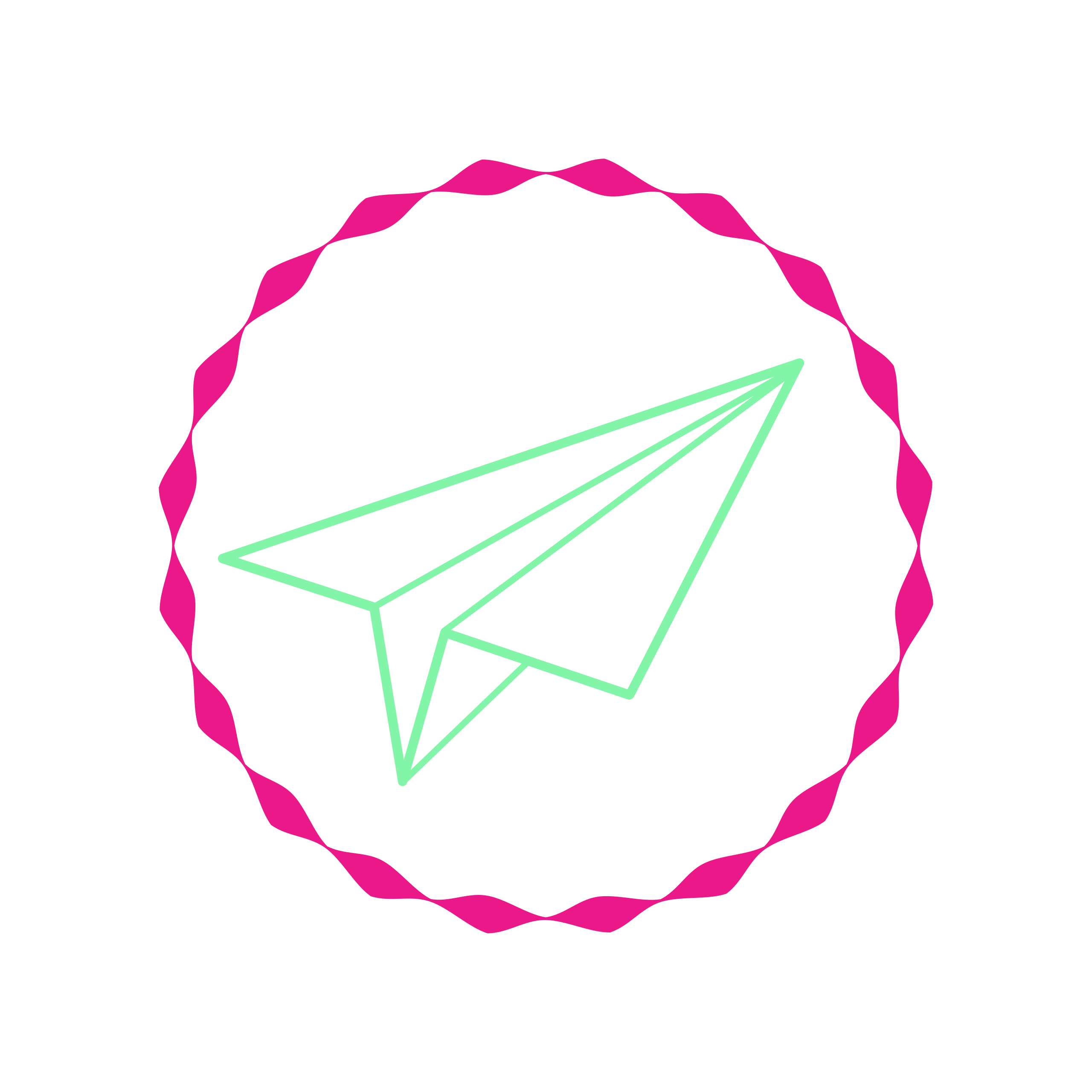Das Weinen
Christoph Marthaler
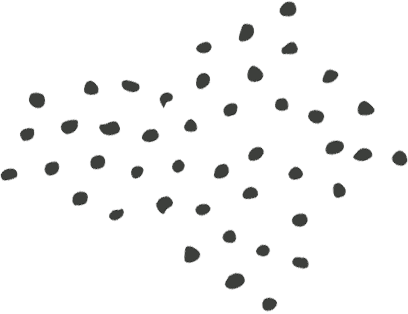
médoc en folie
Christoph Marthaler c’est un peu pour les Suisses, le Castellucci des Italiens, le Cassiers des Hollandais, le Warlikoski des Polonais. Un grand nom de la mise en scène en somme. Capable de produire des oeuvres qui dépassent les frontières. Là encore, invité par le festival d’automne, il ne déroge pas à la règle. Das Weinen sa nouvelle création se déroule dans une pharmacie. Une pharmacie année 70 aux couleurs surannées, propre, clinique, réaliste. Les présentoirent, les néons, le lino. Tout fait vieillot. Un peu hors du temps. Les boites de médicaments sont alignées comme pour le défilé du 14 juillet. Et on sent bien qu’elles sont vides, factices. Dérogeant ainsi aux préceptes de Visconti qui demandait à ses décorateurs de remplir les armoires d’objets, même si personne ne les ouvrait dans la scène. Les pharmaciennes qui travaillent là, dotées de lunettes et de coiffures sévères, ne sont pas plus modernes, comme figées dans le temps, immaculées de blanc. Elles effectuent une chorégraphie précise entre les étagères, les tables, les chaises, le comptoir, la fontaine à eau et l’escabeau. Elles montent les marches, les descendent. Elles vont surtout entonner des dialogues sans le moindre sens, petites ritournelles qui font sonner les mots plutôt que d’énoncer quelque chose. Empruntant à l’enfermement de l’hôpital psychiatrique, la vie ici est absurde et se répète. On comprend vite ce systématisme et on se dit que la pièce aurait pu être plus courte mais il y a quelque chose de jubilatoire à voir ces actrices ânonner sans erreur, avec la plus grande maîtrise et dextérité, ces paroles dénuées de signification. Elles sont empruntées à l’artiste suisse, Dieter Roth et évoquent l’impermanence du monde, l’accident, mais aussi le traitement des mycoses des ongles des pieds, images à l’appui. Marthaler, en bon sculpteur du vide abyssal du monde actuel et du non-sens, est ici au plus proche de ses préoccupations. On reconnaît là son amour pour le dadaïsme et l’oeuvre de Kurt Schwitters en particulier, une certaine mélancolie et un intérêt pour le désuet, son travail sur la musicalité au théâtre lorsque par exemple les pharmaciennes entonnent un lacrimosa de Mozart comme une berceuse.
Même si on nous jure que cette pièce n’a pas été influencée par le contexte sanitaire auquel nous sommes confrontés actuellement, on ne peut s’empêcher d’y voir un clin d’oeil. Dans cette officine, il n’y a pas le moindre client. Comme si nous étions encore une fois confinés. Surtout on sent bien le poids du lobby pharmaceutique tentant de régir nos vies. A chaque maladie son remède semblent nous dire les rayonnages. Mais il s’agit peut-être aussi d’une pièce metoo, puisque un seul homme apparaît sur scène, et il ne pèse rien, littéralement, lorsqu’on le pose sur une balance. Il ne sert à rien non plus. Ou alors il s’efface en Jésus, portant une croix, mais celle verte de la pharmacie et s’écroule sous son poids sans éveiller la moindre compassion des femmes sur scène.
On en sort amusés, interloqués surtout. Sur quel pied danser après cette pièce à voir masqué ?
Thomas Adam-Garnung