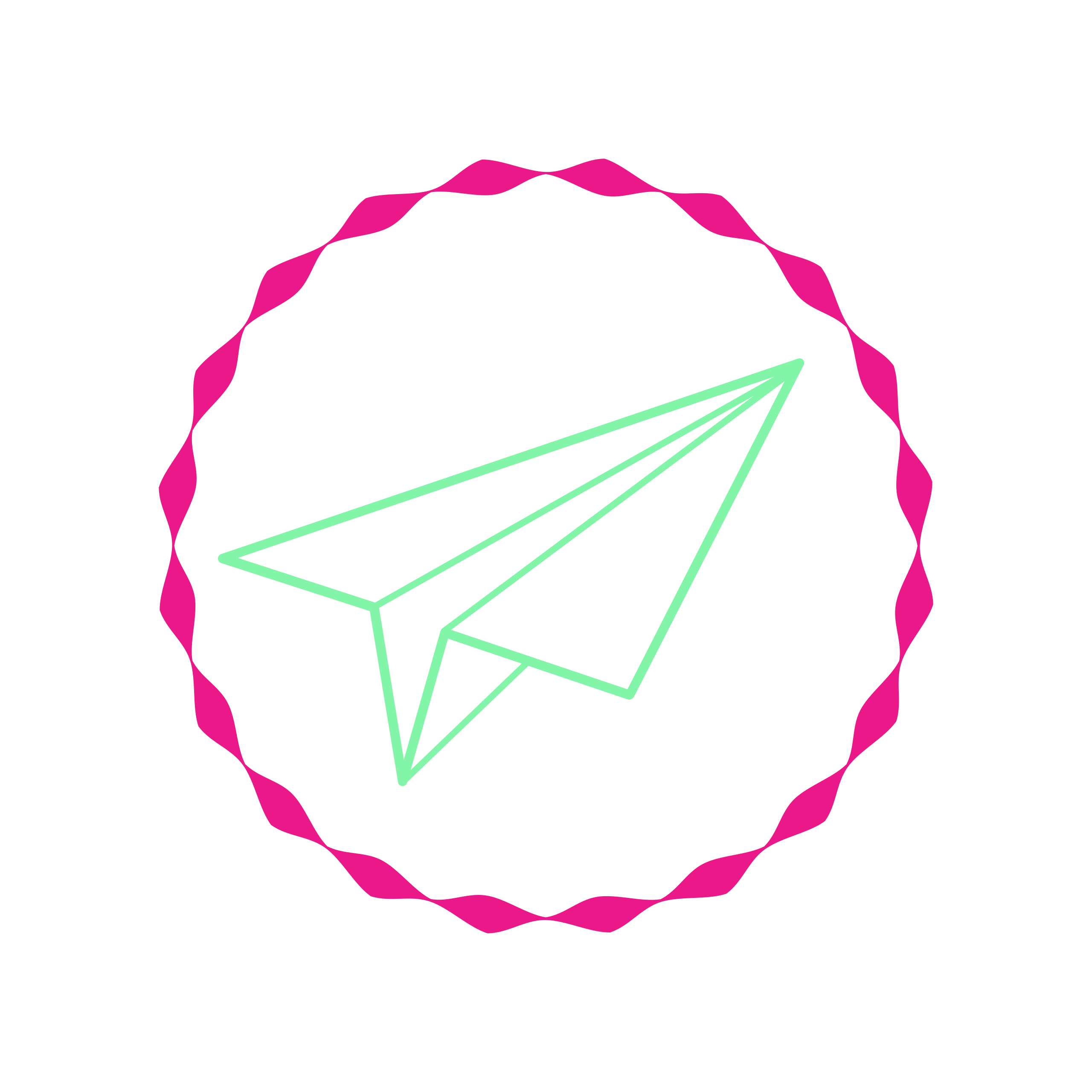Caligula
texte de Albert Camus mis en scène par Jonathan Capdevielle
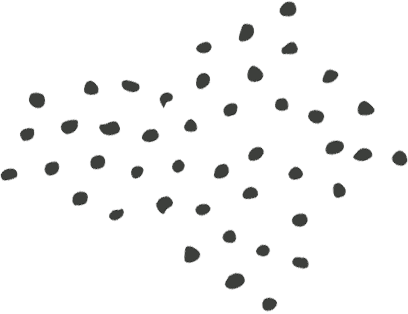
la beauté, dernier acte de résistance
Caligula, Caligula, on pense au tyran, on pense aux pages sulfureuses de Suétone dans ses biographies des empereurs romains, on pense à ce film entre péplum et porno soft de la fin des années 70 avec Malcolm McDowell. Et on se dit que si Jonathan Capdevielle s’empare de cette figure, ça va forcément être à grands coups de provoc facile, de gaudriole grinçante, d’humour potache et convenu pour un entre-soi branché. Habitué du travail avec Gisèle Vienne, metteur en scène lui-même, il n’a jamais vraiment fait dans la dentelle et sait déranger à bon escient. Mais voilà qu’il choisit comme point d’entrée étonnant, le texte de Camus qui de prime abord ne s’appesantit pas vraiment sur les détails croustillants de l’Histoire et a sans doute terriblement vieilli par ses considérations philosophico politiques. Alors on se dit que ces préjugés que nous avons ne sont peut-être pas fondés. Et c’est avec un oeil curieux que nous allons découvrir ce spectacle. D’abord cette scénographie, un gros rocher comme celui de Vollmond de Pina Bausch qui n’évoque pas la pluie mais bien la mer, qu’on entend derrière sans jamais la voir, un rocher dont on s’élancerait pour plonger, un rocher sombre et noir, hostile, inconfortable sur lequel pourtant les corps s’allongent pour profiter d’un soleil artificiel. Ce rocher c’est la ligne de crête, c’est la falaise, c’est l’annonce de la chute. Tout est déjà là. Et le travail de Capdevielle, et le mot travail convient parfaitement tant rien ici n’est gratuit, tant il y a de recherches, d’inventions au service du texte, de son propos, pour le faire entendre, le travail donc est d’une finesse extrême, usant bien évidemment des gimmicks qui sont les siens – oui on verra des culs, oui la sexualité est ici plus qu’évoquée, oui la violence, meurtres et viols sont exposés – mais les dépassant, les rendant presque anecdotiques, démontrant que ces gimmicks ne sont pas ceux de Capdevielle mais ceux de notre société. Surtout il atteint de ci de là des sommets d’intelligence. Le non jeu par exemple qui sonne si juste dans la bouche d’un empereur, le texte proféré sans la moindre émotion, avec une ironie saillante qui signale la distance avec ce qu’il semble vouloir dire et l’absence de psychologie permet de faire passer ce qui serait sans cela inaudible. C’est infime. Précis. Presque chirurgical. C’est le détour nécessaire, pudique, qu’opère l’art dramatique. Et ça frappe direct au coeur. Pourquoi viser ailleurs ? Car il n’y a plus que là que ça peut réagir. Tant la logique de notre monde est mise à mal. Ce monde qui édicte l’argent en valeur et qui ainsi démonétise nos vies. Ce monde où on ne cesse de nous enjoindre d’aller voter mais où cet acte n’a plus de conséquence. Et l’artiste, quel est donc sa place à l’artiste ? Il est là sur scène, son monde, où on ne cesse de lui dire qu’il est libre, libre de tout, alors qu’il n’en est rien. Il pourrait tout y faire parce qu’une pièce de théâtre ne changera rien à la vie. Il pourrait tout y faire parce qu’en fait il se conformera au préalable à la bienséance. Capdevielle expose cette impuissance en explosant le cadre de la représentation : quand le texte ne nous regarde pas, il est dit hors champ ; quand le texte devient inutile, redondant il est couvert par une musique techno ; quand le texte s’écoute le voilà qui se met à chanter. Ce monde court à sa perte, parce que ce monde nous ment, voilà ce que crie Capdevielle. Et nous sommes impuissants, oui. Il ne nous reste que la beauté. Mais c’est peut-être là que réside notre ultime pouvoir.
Thomas Adam-Garnung